L’écologie sera démocratique ou ne sera pas
 Si, comme tout semble l’indiquer, l’avenir passe par l’écologie, la société est bien loin d’y être préparée. Entre peurs, dénis, préjugés, culpabilisations et dépendances à la confortable civilisation du pétrole, comment pourrions-nous emprunter sans heurts ce passage obligé ? Une seule solution : en instaurant une écologie réellement démocratique, avec le peuple souverain dans sa diversité, et relocalisée dans les territoires.
Si, comme tout semble l’indiquer, l’avenir passe par l’écologie, la société est bien loin d’y être préparée. Entre peurs, dénis, préjugés, culpabilisations et dépendances à la confortable civilisation du pétrole, comment pourrions-nous emprunter sans heurts ce passage obligé ? Une seule solution : en instaurant une écologie réellement démocratique, avec le peuple souverain dans sa diversité, et relocalisée dans les territoires.
Les faits se précisent : notre civilisation actuelle, qui repose essentiellement sur la croissance économique et sur une consommation effrénée de ressources fossiles, donnerait des signes de faiblesse, si ce n’est « d’effondrement ».
Et ce ne sont pas les nouvelles technologies, y compris les « vertes », qui devraient la sauver. Grandes consommatrices d’énergie, de métaux (trop) rares (tels que le lithium ou le platine, pour les batteries électriques par exemple, déjà en voie de raréfaction), formées d’alliages complexes rendant impossible leur recyclage, ces fines fleurs d’une méga-industrie coûteuse devraient elles aussi finir par disparaître.
Ce « monde moderne » devenu obsolète cèderait ainsi la place, à relativement brève échéance (dans le siècle), à un nouveau monde à l’écologie plus profonde, plus « intégrale » (pour reprendre les termes du Pape François dans son encyclique très écolo Laudato si), qui reposerait à la fois sur des technologies plus simples, plus naturelles, artisanales et accessibles (low tech), mais aussi sur une nouvelle « résilience sociale » : une transition et une relocalisation des activités humaines, reprises en main par les habitants des territoires, dans le cadre de reconstructions de pratiques collectives « que notre société matérialiste et individualiste avait méthodiquement et consciencieusement détricotées » (Philippe Bihouix, L’Age des low tech, éditions du Seuil).
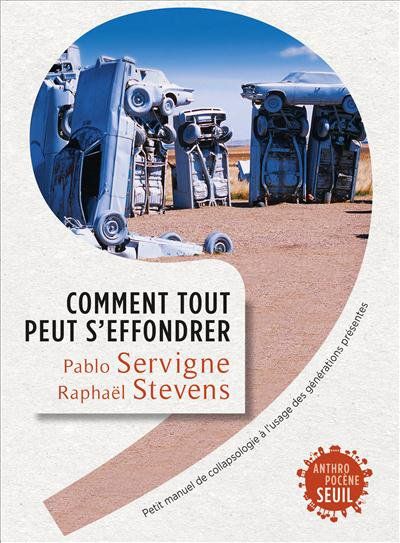
Un avis que partagent Pablo Servigne et Raphaël Stevens, auteurs du désormais célèbre ouvrage Comment tout peut s’effondrer (également aux éditions du Seuil) et qui affirment avec un étonnant optimisme : « Les communautés humaines portent en elles de formidables capacités « d’auto-guérison ». Invisibles en temps normal, ces mécanismes de cohésion sociale très puissants permettent à une communauté de renaître d’elle-même après un choc en recréant des structures sociales qui favorisent sa survie dans le nouvel environnement. »
Auto-guérison ? Vraiment ? La société actuelle est-elle prête à vivre le grand choc d’un changement radical de civilisation ? Où en est l’économie de proximité ? Combien d’AMAPS ? De coopératives d’énergie ? De circuits courts ? De maison de santé naturelle et alternative ? D’écoles tournées vers la nature et la créativité ? Après trente ans d’existence, l’agriculture biologique cherche toujours son second souffle, avec par exemple, en 2016, seulement 5,7% de la surface agricole utile française. Quid des 94,3% de fermes restantes et de leurs agriculteurs, souvent piégés par un système dont ils sont dépendants et souvent malheureux ?
Aussi séduisant et exemplaire soit-il, le mouvement de la transition des territoires reste encore marginal et anecdotique, et il rassemble rarement au-delà de l’habituel cercle de quelques initiés. Tout se passe comme si, face aux enjeux gigantesques auxquels elle devait faire face, la société était atteinte de sidération. Tout à leur impuissance, des mouvements, souvent de jeunes citadins, formés via les « réseaux sociaux », versent dans une violence de culpabilisation – et parfois d’auto-culpabilisation et de haine de soi – sans changer quoi que ce soit – ou si peu – à leurs modes de vie de gagnants de la mondialisation des moins écologiques.
Cette grande aventure de l’écologie devrait pourtant avoir lieu. Elle va dans le sens de l’histoire. A condition que nous prenions pleinement conscience de tout ce qui nous freine et nous bloque dans cet objectif. Ces freins, ces blocages, ces obstacles sont multiples et complexes. Ils ne sont ni scientifiques, ni techniques, ni économiques : ils sont humains, et souvent inconscients.
Sommes-nous prêts au fond à abandonner le confort de la civilisation industrielle ? Avons-nous suffisamment confiance pour nous mobiliser ensemble dans une multitude de chantiers collectifs, relocalisés, créatifs et transformateurs, partout sur nos territoires, dans nos villes, nos villages, nos entreprises, nos quartiers, nos universités ? Les écologistes sont-ils prêts à oeuvrer avec les « autres » : les « consommateurs », les « mondialistes », les « pollueurs », les « Gilets jaunes », les « chasseurs » ?
Ces « autres » sont-ils prêts à avancer avec ceux qu’ils appellent parfois les « rêveurs », les « farfelus », les « irresponsables », ou pire, les « khmers verts » ?
De quoi et de qui les uns et les autres nous sentons-nous victimes ? Quels sont, en ces temps de crises multiples, nos doutes, nos craintes, nos soupçons quant à ce grand dessein – et destin – écologique ?
Comment vivons-nous cette idée de nous lancer dans l’inconnu, dans l’incertain ? Finalement nos peurs de l’écologie correspondent-elles à des dangers réels ou bien imaginaires ? De quels sentiments d’insécurité, d’impuissance et de découragement sommes-nous encore prisonniers ? Quelle est la réalité, la taille et la nature de cette montagne à franchir ? Ces questions, essentielles, doivent être posées, explorées ensemble, avec tous les citoyens dans leur souveraineté. Mais de quels espaces d’expressions libres et démocratiques disposons-nous pour accomplir cela ?
La Déclaration de Lézan
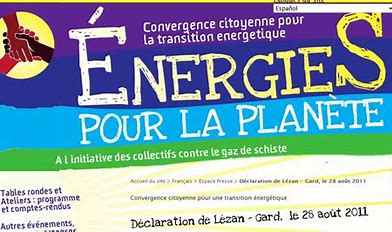
Au début de l’été 2011, je fus appelé par une amie urbaniste avec laquelle j’avais travaillé, et qui s’était engagée dans les Collectifs nationaux de lutte contre l’exploitation industrielle des gaz des schistes. Elle oeuvrait à un grand projet de rassemblement écologiste programmé à la fin du mois d’août – la Convergence citoyenne pour une transition énergétique – et pensa à moi pour en confier la coordination. Cet événement d’envergure nationale avait été pris en main par une diversité de gens venus des quatre coins du pays, et de tous les horizons (partis politiques, associations écologistes et/ou altermondialistes, collectifs citoyens, etc.), mais qui restaient très méfiants les uns envers les autres. Mon rôle fut de favoriser entre eux les conditions d’échanges constructifs, d’organiser et accompagner des débats contradictoires, allant jusqu’à initier, en plein rassemblement, la rédaction collective de la Déclaration de Lézan.
La Déclaration de Lézan est un véritable projet politique, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire : elle revendique « une démocratie directe grâce à des espaces citoyens d’échanges, d’information, de confrontations et de décision ». Elle appelle à s’engager pour la transition énergétique, notamment en « organisant la relocalisation avec la réappropriation publique et territoriale des moyens de production et de distribution de l’énergie (régies communales, coopératives, sociétés d’intérêts collectifs, etc.) incluant systématiquement le contrôle citoyen. » Mais la grande originalité de cette Déclaration, c’est qu’elle est justement le fruit d’un processus d’élaboration démocratique, nous ayant fait franchir les différentes étapes nécessaires à sa construction : ateliers et débats « convergents » – organisés de façon à faire circuler la parole et favoriser les confrontations de points de vue -, assemblée pour rapporter les convergences, auto-désignation d’un comité de rédaction d’une déclaration commune reprenant ces convergences, et enfin validation de la-dite Déclaration en assemblée plénière le lendemain. En sortant de nos anciens cadres, en libérant la spontanéité, nous avions réussi quasi-miraculeusement là où la plupart des rassemblement écologistes et altermondialistes avaient échoués jusqu’alors : écrire ensemble et démocratiquement un texte où chacun s’y retrouvait, et immédiatement publiable dans la presse.
 La thérapie sociale
La thérapie sociale
Lorsque j’étais journaliste social et communicant public, j’avais pu éprouver – jusque dans ma vie personnelle – combien la société et ses « corps sociaux » pouvaient être malades de leurs divisions, de leurs séparations, dépressions et pathologies collectives, jusque dans les villages, les quartiers, les territoires, les organisations, les institutions, les familles, les couples.
Un an après Lézan, je me demandais comment je pourrais bien participer à nouveau à de telles aventures démocratiques, non plus seulement avec les « convaincus » de l’écologie, mais avec les citoyens dans toute leur diversité socio-culturelle. Aussi je n’hésitai pas longtemps à m’engager dans le long processus de formation à la Thérapie sociale TST, dans une promotion animée par le fondateur de cette nouvelle et inédite approche, Charles Rojzman (Freud, à la fin de sa vie, avait perçu tout l’intérêt de s’attaquer au maladies collectives – voir Malaise dans la civilisation, 1930). Car l’une des principales spécificités de notre métier d’intervenant en Thérapie sociale TST est de savoir créer, à l’intérieur de cellules sécurisées, les conditions pour une transformation des blocages et des violences relationnelles et institutionnelles, permettant le rétablissement d’un dialogue conflictuel nécessaire à d’authentiques débats démocratiques constructifs, rendant enfin possibles les nécessaires transformations sociales.
Comme le clame Charles Rojzman depuis une trentaine d’années, « NOUS AVONS BESOIN DE TOUS » : afin de cerner au mieux la réalité des problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés, et en explorer ensemble des solutions concrètes en intelligence collective, il est nécessaire que nous puissions à nouveau nous réunir entre citoyens, avec nos différences. Nous avons besoin de faire émerger une nouvelle démocratie populaire – c’est-à-dire réellement démocratique et réellement populaire – qui permette à chacun de faire valoir ses propres besoins et motivations et de se faire sa propre place sur son territoire, dans son institution, dans la société.
Réussir la relocalisation des activités humaines, cela passe donc par une écologie réellement démocratique, qui rassemble dans de multiples « cellules de rencontres et de coopération » la diversité sociale, culturelle et professionnelle des territoires. Il s’agit autrement dit de pouvoir créer ensemble des « écosystèmes humains », qui, une fois rétablis dans leurs capacités à se confronter librement, sincèrement et en intelligence collective, pourront atteindre ensemble des objectifs communs, s’engager ensemble dans de multiples chantiers de relocalisation, de transition ou de transformations sociales (de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’industrie, de l’artisanat, de l’habitat, de l’éducation, de la culture, etc.), en faisant en sorte d’intégrer la diversité des besoins et des motivations, ainsi que la réalité des ressources naturelles, culturelles et économiques locales, et chercher ensemble des réponses adaptées à la complexité et aux différentes contraintes (y compris étatiques), sans que ce soient les « acteurs sociaux » habituels – et désormais fatigués – qui s’y collent encore et toujours.
Yves Lusson
Article paru le 7 décembre 2019 dans Tribune Juive



Laisser un commentaire